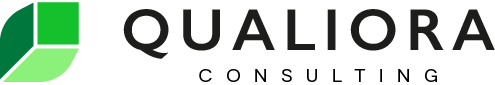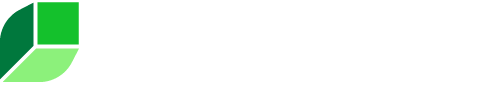D’ici 2030, la demande mondiale en protéines devrait augmenter de 40% en raison de la croissance de la population et des changements dans les régimes alimentaires.
Pour faire face à cette augmentation, il devient primordial d’utiliser de nouvelles sources de protéines comme des protéines végétales en complément des protéines animales. Bien qu’elles soient de plus en plus répandues, il existe encore des obstacles à leur développement tant du point de vue de la production que de la consommation.
Le challenge pour les années futures sera donc de surmonter ces obstacles afin d’accroître l’acceptabilité des protéines alternatives dans notre alimentation globale.
Il existe cinq grandes sources de protéines alternatives en cours de développement en Europe : les substituts à la viande d’origine végétale, la viande cultivée en laboratoire, les produits issus de la fermentation, les insectes comestibles et les algues.

Les protéines végétales
Selon l’ONU, la production agricole mondiale devrait augmenter de 70% d’ici 2050 pour nourrir les 9 milliards d’habitants. Même avec un renforcement du secteur de l’élevage et de la filière de transformation des viandes, on ne pourra satisfaire cette demande. C’est pourquoi la recherche s’intéresse actuellement à d’autres sources de protéines, telles que les protéines végétales.
Les protéines végétales proviennent essentiellement des légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois chiches …), des céréales (blé, riz, avoine, maïs …), des pseudo-céréales (quinoa, sarrasin,…), des fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes …) et des graines oléagineuses (colza, sésame, arachide …).
Elles présentent de nombreux avantages dont :
Moins de matières grasses saturées
Les protéines alternatives sont souvent plus faibles en matières grasses saturées que la viande. Or, les aliments d’origine animale riches en graisses saturées sont associés à un risque accru de problèmes cardiaques. En optant pour des sources végétales ou d’autres alternatives, vous pouvez améliorer votre santé cardiovasculaire.
Impact environnemental réduit
Moins de terres agricoles sont nécessaires pour produire des protéines végétales, car elles peuvent être cultivées en utilisant des techniques de culture verticale ou hydroponique. Cela signifie que nous pouvons cultiver davantage de nourriture sur une surface plus petite, réduisant ainsi la pression sur les terres agricoles et préservant les habitats naturels.
En ce qui concerne l’utilisation de l’eau, les protéines alternatives nécessitent également moins d’eau pour leur production. Par exemple, la production d’un kilogramme de viande bovine peut nécessiter jusqu’à 15 000 litres d’eau, tandis que la production d’un kilogramme de soja ne demande que 900 litres d’eau.
Un autre avantage environnemental des protéines alternatives est leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’élevage intensif est responsable d’une grande partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment le méthane provenant du bétail et le dioxyde de carbone résultant du défrichement des terres pour le pâturage et la culture du fourrage.

Les enjeux futurs pour le déploiement des protéines alternatives
Bien que de nombreuses raisons existent pour encourager le développement des protéines végétales, celles-ci ne représentent encore qu’une petite partie des grandes cultures et sont caractérisées par une faible diversité (majoritairement du soja).
Pour favoriser leur adoption à grande échelle, il est nécessaire de surmonter de nombreux obstacles à tous les niveaux de la chaîne de valeur.
La structuration des filiales locales
Il est essentiel de soutenir et promouvoir la production locale de protéines végétales en encourageant les agriculteurs à cultiver des cultures riches en protéines de manière économiquement viable. Il est également nécessaire d’investir dans des infrastructures industrielles performantes au niveau local.
La recherche doit quant à elle se concentrer sur la réduction de la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que sur l’amélioration des rendements de récupération.
L’acceptation des produits à base de protéines végétales par le consommateur
Bien que ces sources de protéines aient connu un regain d’intérêt au cours de la décennie précédente, elles ne représentent à l’heure actuelle qu’environ 30% de l’apport protéique total d’un individu moyen en France alors qu’il devrait idéalement être de 50%.
Ce constat est paradoxal : alors que les protéines végétales bénéficient d’une image très positive auprès des consommateurs (pour des raisons essentiellement environnementales et de santé), l’offre actuelle de steaks à base de tofu ou de seitan, boissons, desserts, fromages végétaux… ne semble pas pleinement leur convenir.
L’amélioration des procédés de transformation
Au cours de la transformation de la plante brute en produit fini, les protéines subissent des modifications structurales qui nuisent à leur fonctionnalité. La mise au point de procédés de transformation à froid, pour ne pas dénaturer les protéines et produire des isolats à haute valeur fonctionnelle (tout en garantissant leur sécurité alimentaire), est donc au cœur de cet enjeu.
La lentille d’eau : un exemple de protéines alternatives parfaites ?
La lentille d’eau est consommée depuis des centaines d’années en Asie du Sud-Est en raison de sa forte teneur en protéines (plus de 45% de la matière sèche). Elle aurait un profil protéique comparable à celui des œufs, avec neuf acides aminés essentiels et six autres acides aminés.
En outre, elle est très riche en antioxydants puissants, en fibres alimentaires, en minéraux (fer et zinc notamment), en vitamine A, et même en vitamine B12. Un apport particulièrement intéressant puisque la vitamine B12 est surtout présente dans les produits issus d’animaux.
Cette plante aquatique aurait en outre l’avantage d’être facile à cultiver, en nécessitant assez peu d’eau par gramme de protéine produit, du moins par rapport au soja, aux épinards ou aux choux.
La lentille d’eau semble donc ne présenter que des avantages et c’est pourquoi elle intéresse de nombreux chercheurs à travers le monde. Elle fait donc partie des protéines que nous trouverons peut-être un jour massivement dans notre alimentation.

Les insectes : une autre source de protéines alternatives
Parmi les pistes pour diminuer la part de produits carnés dans notre alimentation, les insectes figurent en bonne place : riches en protéines et peu coûteux à produire, ils ont de solides atouts. Certes, ils doivent encore surmonter la réticence des consommateurs occidentaux, peu adeptes de ce genre de mets, et les contraintes réglementaires. Mais les obstacles se lèvent peu à peu.
Avantages des protéines à base d’insectes
Les insectes comestibles offrent de multiples avantages pour l’environnement. Ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que la plupart des autres sources de protéines animales et nécessitent moins d’eau.
De plus, les superficies requises pour les élever sont nettement moins importantes que celles nécessaires à la production animale. Ils présentent un très bon rendement de conversion des intrants alimentaires en protéines. Les grillons, par exemple, ont besoin de 12 fois moins d’intrants alimentaires que les bovins pour produire la même quantité de protéines.
Enfin, ils sont facilement intégrables dans l’alimentation de tous les jours, que ce soit sous forme de farine ou de poudre dans un milkshake par exemple.
Protéines alternatives : en conclusion
La modification de nos habitudes alimentaires sera un point capital dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera également un enjeu majeur si nous voulons pouvoir nourrir les milliards d’humains présents sur notre planète dans les années à venir.
De nombreuses alternatives aux protéines d’origines animales sont possibles et offrent de nombreux avantages, tant au point de vue nutritionnel qu’environnemental. Bien que le marché se soit considérablement développé depuis quelques années, ils ne tient qu’à nous de les intégrer plus entièrement dans notre alimentation afin de développer un autre futur de consommation.